Sansuke Yamada : « Tout ce qui a existé mérite d’être montré »

 Invité au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême à l’occasion de la sortie simultanée des deux premiers tomes de sa série Sengo, Sansuke Yamada est revenu avec nous sur son manga atypique. On y suit les errements de deux vétérans de l’armée japonaise revenus du front vivants, mais meurtris, et qui se retrouvent dans le Tokyo ravagé d’après-guerre. Prix de la nouveauté au Prix Culturel Osamu Tezuka et Grand Prix de l’association des auteurs de bandes dessinées japonaises, la série est actuellement en compétition pour le Prix Asie de la Critique ACBD 2020. Afin de creuser la richesse et l’angle d’approche très humain de son œuvre, le mangaka a évoqué avec nous son goût pour l’histoire, les films japonais d’après-guerre, les « bromances », la sexualité et sa minutie du dialogue.
Invité au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême à l’occasion de la sortie simultanée des deux premiers tomes de sa série Sengo, Sansuke Yamada est revenu avec nous sur son manga atypique. On y suit les errements de deux vétérans de l’armée japonaise revenus du front vivants, mais meurtris, et qui se retrouvent dans le Tokyo ravagé d’après-guerre. Prix de la nouveauté au Prix Culturel Osamu Tezuka et Grand Prix de l’association des auteurs de bandes dessinées japonaises, la série est actuellement en compétition pour le Prix Asie de la Critique ACBD 2020. Afin de creuser la richesse et l’angle d’approche très humain de son œuvre, le mangaka a évoqué avec nous son goût pour l’histoire, les films japonais d’après-guerre, les « bromances », la sexualité et sa minutie du dialogue.
À la lecture, c’est une évidence : vous connaissez avec précision la période de l’avant et l’après Seconde Guerre mondiale au Japon. Comment vous êtes-vous documenté sur cette période ?
Depuis l’enfance, j’ai l’habitude de m’intéresser aux photos de presse, aux carnets de guerre et aux documents historiques. J’ai aussi lu beaucoup de littérature enfantine dont les auteurs avaient fait l’expérience de cette période. J’en suis donc depuis longtemps familier. En grandissant, je me suis également mis à regarder beaucoup de films qui traitaient de la guerre et de l’après-guerre. C’est une époque qui m’intéresse énormément et je pense que toutes ces œuvres m’ont nourri et m’ont permis de me lancer dans l’écriture de Sengo.
En manga, les auteurs traitent généralement du moment de la guerre, de la défaite ou de la reconstruction. Là vous êtes sur le versant humain, sur le quotidien et l’impact que les atrocités de la guerre ont eus sur les individus. Pourquoi avoir choisi de traiter le sujet de cette manière ?
Il faut y voir l’influence des films de cette époque. Ils s’attachent souvent à dépeindre les relations entre les personnages, et c’est même souvent l’axe principal de leur narration. Ça a toujours été ce qui m’a le plus intéressé dans ces films et je pense que c’est pour ça que je me suis tourné naturellement vers ce procédé de traitement de cette période.
 Est-ce qu’il y a des films qui vous ont plus marqué que d’autres ?
Est-ce qu’il y a des films qui vous ont plus marqué que d’autres ?
La première œuvre qui me vient à l’esprit est un film Yūzō Kawashima qui s’appelle Chambre à louer. Il y a aussi Pas de consultations aujourd’hui de Minoru Shibuya. Ce sont deux films inspirés de romans de Masuji Ibuse, un auteur japonais très important et que j’apprécie beaucoup. Il a notamment écrit Pluie noire, un récit en rapport avec le bombardement atomique de la ville de Hiroshima.
Qu’est-ce qui vous plait particulièrement dans ces deux films ?
C’est en lien avec ce que vous évoquiez tout à l’heure. Ces œuvres ont plus tendance à mettre en scène le quotidien, à décrire l’époque et à se centrer sur les personnages. Pour Chambre à louer, on suit l’histoire de gens qui vivent dans une maison collective et la manière dont leurs rapports sociaux s’interconnectent. Dans le deuxième, Minoru Shibuya met en scène la patientèle d’un médecin de quartier. Il expose sa place dans la société, la manière dont il fonctionne…
Dans Sengo, les hommes sont là, vivants, survivants plutôt, car morts de l’intérieur. L’un s’échappe de la réalité en plongeant dans l’alcool, l’autre dans la gaudriole… et les deux vivent une bromance dans un Tokyo ravagé. Il y a une véritable authenticité, tant dans le ton que dans le langage joyeusement fleuri ou dans l’environnement dépeint. Comment faites-vous pour arriver à ce réalisme ?
En mettant en scène ces deux personnages, je n’avais pas l’impression de faire quelque chose de tellement nouveau. C’est finalement un canevas qu’on retrouve régulièrement dans ce qu’on appelle les buddy movies où deux personnages se rencontrent et s’entraînent l’un l’autre. Je n’ai pas eu de réflexion particulière à ce propos, c’est quasiment les circonstances qui ont fait que la mise en scène a appelé ces deux personnages.
Ni vous ni moi n’avons vécu dans le Japon de cette époque, mais votre manga respire le réalisme… Comment faites-vous pour arriver à capter la justesse d’une époque comme celle-ci ?
C’est une démarche qui est plutôt inconsciente, mais je pense que ça vient du fait que dès que je regarde un film ou que je lis un manga, j’ai systématiquement un regard critique, notamment sur les dialogues. J’ai toujours tendance à juger de manière assez nette tout ce que je peux lire et regarder. À chaque fois je me demande si tel dialogue ou telle situation est plausible ou non. J’essaie d’avoir la même sévérité dans la création de mon manga et en particulier dans la création des dialogues. Je pense qu’ils participent beaucoup à créer une ambiance qui paraît réaliste.
 On en revient donc aux films… C’est l’une de vos inspirations majeures ?
On en revient donc aux films… C’est l’une de vos inspirations majeures ?
Tout à fait. J’ai essayé de restituer cet espace de langage qu’on trouve dans les films des années 50-60 et qui restent dans l’oreille. C’est assez musical, donc c’est plus facile en matière de cinéma, mais essayer de reproduire ça à l’écrit était un de mes buts.
Les mangas qui nous montrent la guerre autrement sont assez rares en France. On pense évidemment à Opération mort de Shigeru Mizuki, mais aussi au beaucoup plus récent Peleliu – Guernica of Paradise de Kazuyoshi Takeda. Est-ce qu’il y a des titres historiques qui vous ont personnellement marqué et peut-être même inspirés pour votre œuvre ?
Opération Mort. Je pense que c’est la référence ultime. Shigeru Mizuki est un auteur qui a l’expérience réelle de cette période, du terrain, des relations humaines, des relations hiérarchiques à l’intérieur de l’armée, du type de conversation qu’on peut avoir avec un officier supérieur, avec un égal… Et dans le choix des mots ou dans les thématiques abordées, je pense que c’est quelque chose qu’il est impossible d’imaginer à partir de zéro.
Vous n’êtes pas tendre avec les exactions de toutes sortes de la part des Américains sur le sol japonais, de leurs comportements inacceptables en passant par les viols de civils… Qu’est-ce que vous souhaitez montrer avec votre manga ?
C’est le type de description qui est relativement peu présent dans les mangas à l’heure actuelle et qu’il me paraissait nécessaire de dessiner. Au-delà de ça, il n’y a pas de velléité symbolique, philosophique, politique ou de message en particulier. Mon idée est de passer dans une brèche, d’essayer de trouver des interstices, des choses qui n’existent pas encore et d’essayer de les développer. C’est là que je trouve mon challenge dans mon métier d’auteur.
 Vous n’êtes pas tendre avec les Américains, mais vous n’épargnez pas les Japonais non plus : les femmes qui sont aux bras des Américains, les soldats démobilisés moqués dans la rue par leurs concitoyens… L’idée est donc d’essayer de trouver une certaine objectivité ?
Vous n’êtes pas tendre avec les Américains, mais vous n’épargnez pas les Japonais non plus : les femmes qui sont aux bras des Américains, les soldats démobilisés moqués dans la rue par leurs concitoyens… L’idée est donc d’essayer de trouver une certaine objectivité ?
Oui. À mon avis, l’essentiel est de montrer ce qui a pu exister en essayant de faire un état des lieux objectif de la situation. Je vous parlais de photos de presse tout à l’heure, en réalité tout ce que je fais découle d’une envie de savoir et de permettre aux gens de savoir. Je pense que le jugement vient après la connaissance. Évidemment que je n’ai pas l’expérience personnelle de ces choses-là, mais ce sont des faits véridiques, j’ai donc estimé important de les dépeindre. Et je pense que si les autres pays qui ont vécu des choses équivalentes les dépeignaient, on aurait tous à y gagner. Je pense sincèrement que tout ce qui a existé mérite d’être montré.
Les événements évoqués sont décrits dans leur manière la plus crue possible, mais votre œuvre n’est pas pesante pour autant. Elle porte une sorte de fausse légèreté douce-amère, un certain détachement. Pourquoi ce choix ?
J’ai bien conscience que la réalité devait être autrement plus lourde que ce que je dépeins, mais si je me suis engagé dans cette voie, c’est parce que la plupart des films d’époque qui m’ont nourri sont des œuvres de divertissement. C’est dans cette veine-là que je voulais rester.
Votre dessin n’est pas commun, ne rentre pas dans les canons du genre manga. Comment en êtes-vous arrivé là ?
Je pense que ce qu’on considère comme le style manga le plus en vogue en ce moment, c’est quelque chose qui est apparu dans la deuxième moitié des années 1980 – et peut-être même la première moitié si on inclut Rumiko Takahashi. Ce style s’est imposé après, dans les années 1990, avec le développement de la culture otaku. Je fais partie de la génération qui a vu le manga prendre beaucoup d’importance et s’uniformiser, notamment par des contraintes de temps et de méthode de travail.
Et pourquoi ne pas vous en être inspiré ?
Je trouve que c’est un style qui colle et fonctionne bien avec un motif en particulier. Mais moi, ce que j’avais à décrire, c’était quelque chose qui est difficile de rendre crédible avec ce type d’esthétique. Mais s’il se trouve qu’à un moment donné ça puisse servir mon propos et avoir une efficacité avérée, je suis absolument prêt à me tourner vers ce style.
Vous avez justement un deuxième style de dessin qui intervient lorsque vous traitez des actes de guerre ou lors des mises à mort. Votre trait est beaucoup plus encré, plus épais, moins précis pour ces scènes-là. Pourquoi ?
Ces scènes sont réalisées à la plume alors que le reste du dessin est encré au stylo-feutre. La plume est un outil que j’utilise dans les scènes où j’ai besoin de donner un impact à la lecture. Je me sens moins libre quand je dessine avec la plume, et ce manque de liberté m’oblige à mettre plus d’énergie dans le trait. C’est une contrainte que je me fixe pour essayer d’arrêter le regard du lecteur sur ce genre de case.
 Vous avez fait les Beaux-arts d’Osaka, vous êtes chanteur dans un groupe de musique et vous avez commencé en publiant dans la presse gay. Comment expliquez-vous votre parcours ?
Vous avez fait les Beaux-arts d’Osaka, vous êtes chanteur dans un groupe de musique et vous avez commencé en publiant dans la presse gay. Comment expliquez-vous votre parcours ?
Dans le Japon actuel, faire carrière en tant que chanteur ou musicien est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Je connais beaucoup de gens très talentueux, mais qui sont contraints d’avoir une activité professionnelle « normale » pour pouvoir faire leur musique à côté. Le système est tel qu’on ne peut pas vraiment faire carrière en tant que musicien, alors je me suis tourné vers autre chose.
Et pourquoi cette autre chose a été le manga ?
Le système éditorial au Japon fait en sorte qu’être auteur est quelque chose qui peut être considéré comme un métier, dans le sens où cela assure un revenu et une espèce de stabilité sociale. Le manga, c’est épisodique : réussir à dessiner 24 pages par mois peut suffire à vivre une vie normale au Japon.
Vous aviez commencé dans la presse gay avant de vous lancer dans cette série. Pourquoi ce choix ?
C’est presque un hasard. C’est surtout parce que j’avais conscience que j’arrivais mieux à dessiner les hommes que les femmes. Puis c’est en voyant les illustrations qui étaient dans la presse gay que je me suis senti assez confiant pour pouvoir faire mon trou tout en proposant une vision différente. Alors après, pourquoi est-ce que je me suis plutôt tourné vers la presse gay plutôt que vers des publications hétérosexuelles, c’est tout simplement parce que dans le milieu de la presse gay, la concurrence était moins rude.
Qu’est-ce qui vous attirait particulièrement dans ces publications ?
De manière plus globale, la thématique de la sexualité est quelque chose qui m’intéresse beaucoup. Et dans le monde où on consomme du porno hétérosexuel, le rôle principal revient souvent aux femmes, alors que moi ce qui m’intéresse, c’est ce qu’il y a l’intérieur de moi. Étant un homme, je souhaitais décrire les pulsions des hommes et c’est peut-être aussi pour ça que je me suis tourné vers des choses qui étaient plus proches du monde homosexuel qu’hétérosexuel.
 Gengoroh Tagame (auteur culte issu de la presse gay, connu par le grand public grâce au Mari de mon frère) s’est plaint il y a quelques années qu’il n’existait plus vraiment de magazines gays dans lesquels il pouvait publier ses histoires et illustrations…
Gengoroh Tagame (auteur culte issu de la presse gay, connu par le grand public grâce au Mari de mon frère) s’est plaint il y a quelques années qu’il n’existait plus vraiment de magazines gays dans lesquels il pouvait publier ses histoires et illustrations…
C’est vrai. Je pense que ça tient à l’époque que l’on vit. Le type de contenus que les lecteurs de presse gay allaient chercher dans les pages des magazines est aujourd’hui librement accessible sur internet. Je pense que c’est une tendance assez générale dans la presse magazine.
Et vous continuez à travailler pour la presse gay qui perdure ?
Presque pas, ça fait très longtemps que je n’ai rien publié dans la presse gay.
Volontairement ?
D’une part, les offres se sont effectivement taries. D’autre part, j’ai aussi été confronté à un dilemme après avoir participé à ce genre de publications. J’ai eu le sentiment que les choses qu’on me demandait étaient trop redondantes.
Comment ça ?
Les magazines gays sont en fin de compte des magazines pornos à destination d’un public homosexuel, et ce que ce public cherche c’est à consommer de la pornographie. On ne s’y s’intéresse pas particulièrement à la sexualité masculine à proprement parler. Comme c’est le point qui m’intéresse le plus, il y avait donc un décalage entre ce qu’on me demandait et ce que je voulais vraiment créer.
Sengo s’est terminé il y a deux ans au Japon. Est-ce que vous allez vous lancer sur une histoire d’un tout autre genre ou continuer à creuser dans la même direction ?
J’aimerais me tourner vers autre chose, mais j’ai l’impression que j’ai encore plein de choses à dessiner sur l’époque que je décris dans Sengo. Il y a de bonnes chances que je reste dans la même veine.
Vous avez déjà commencé à réfléchir à quelque chose ?
Oui, mais je suis encore un peu dans le brouillard !
Propos recueillis par Rémi I.
Merci à Angèle Pacary (Casterman) pour la mise en place de l’interview et à Sébastien Ludmann pour l’interprétariat.
Sengo.
Par Sansuke Yamada.
Casterman, 9,45 €, tome 3 (sur 7) le 1er juillet 2020.
© AREYO HOSHIKUZU © YAMADA Sansuke 2014 / KADOKAWA CORPORATION
__________________________



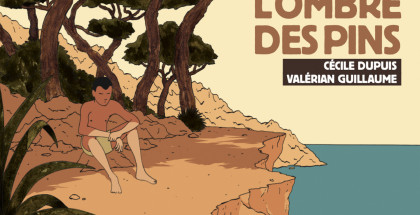






Publiez un commentaire